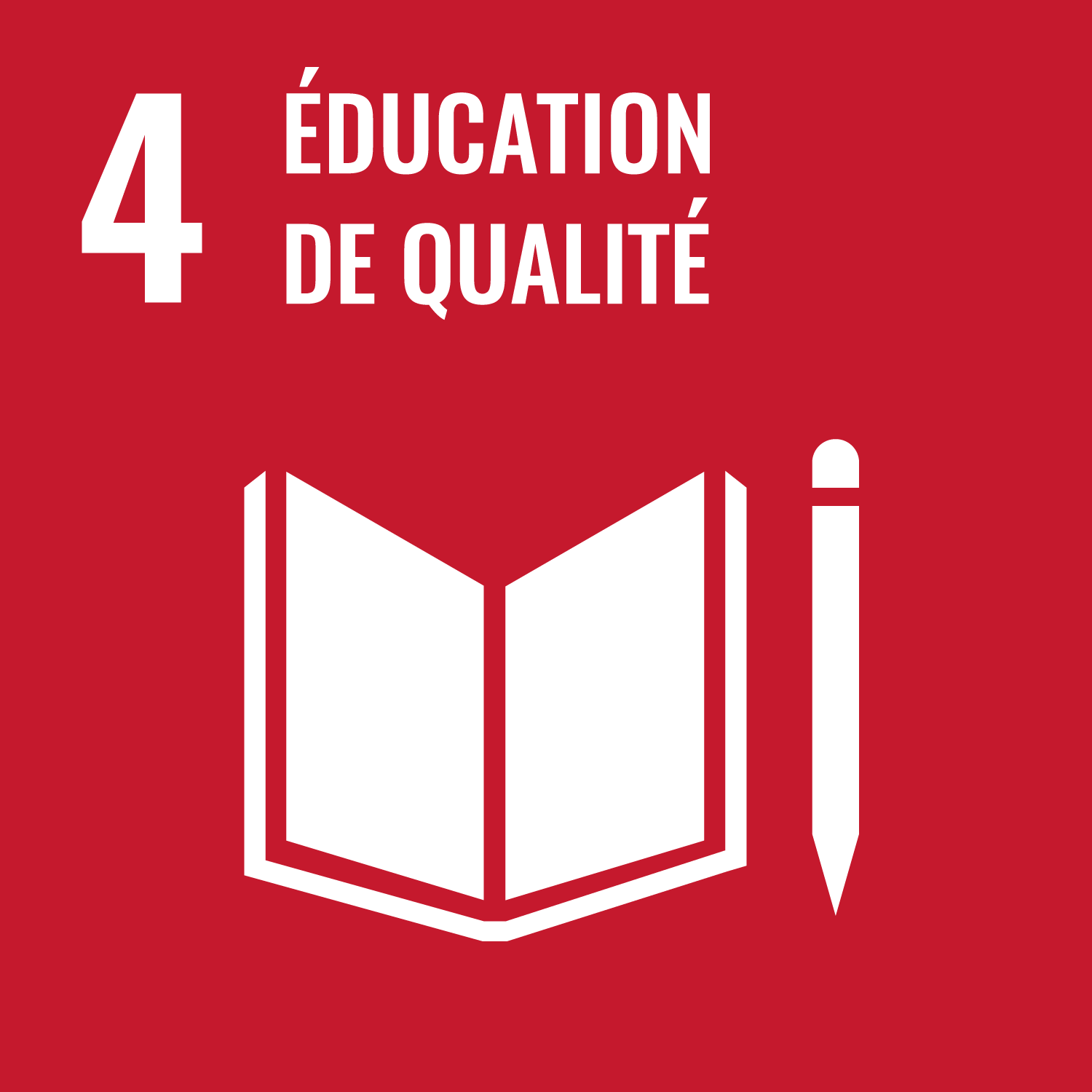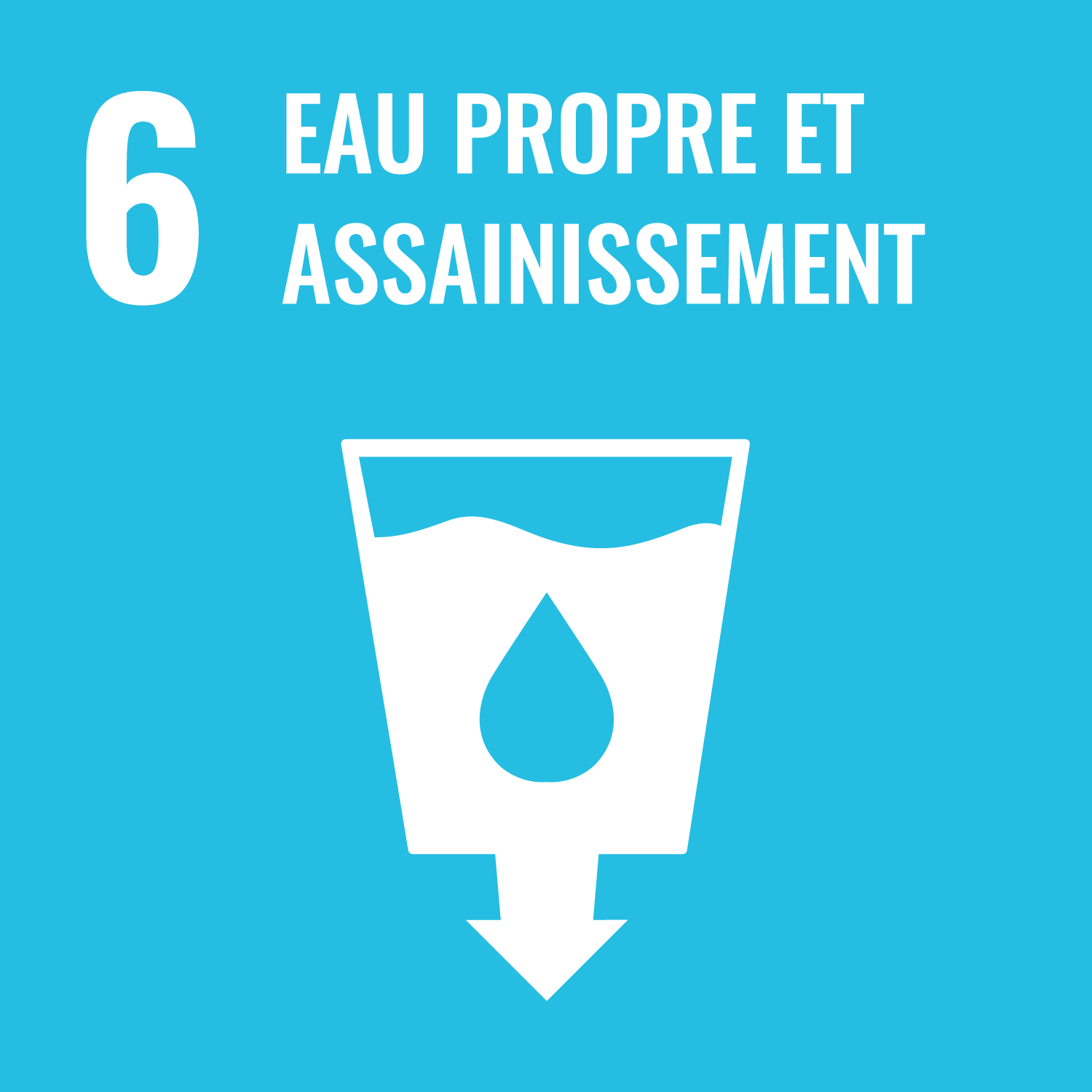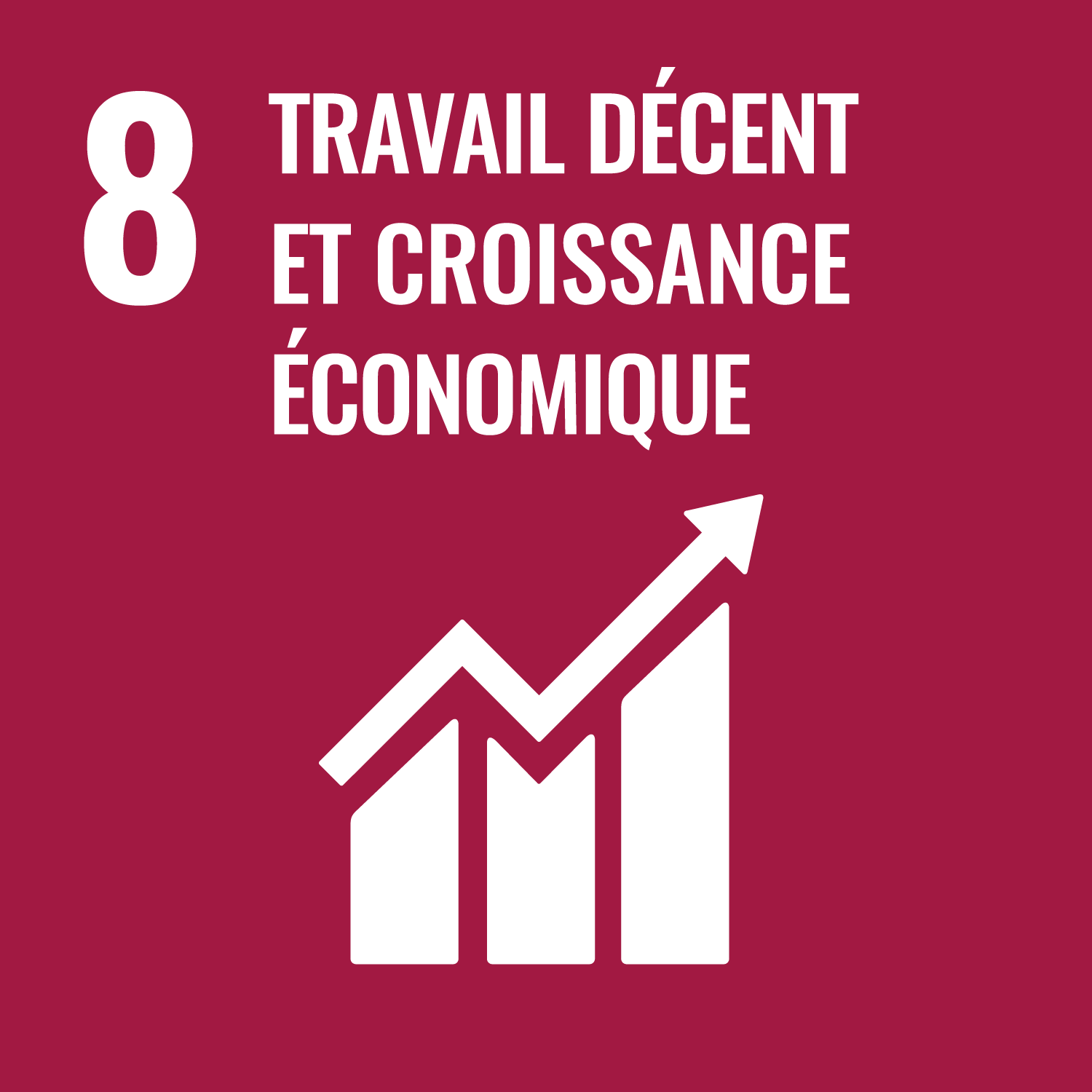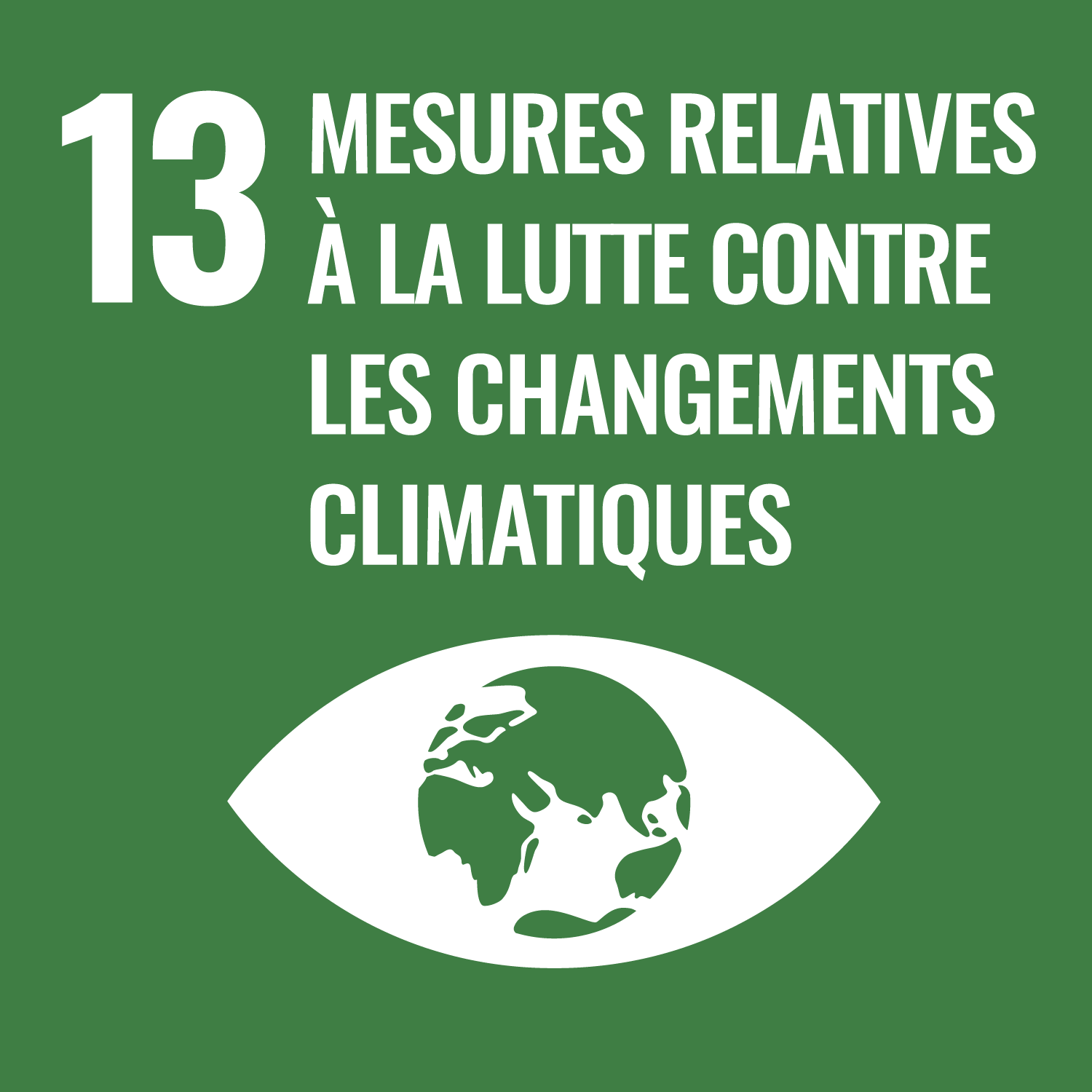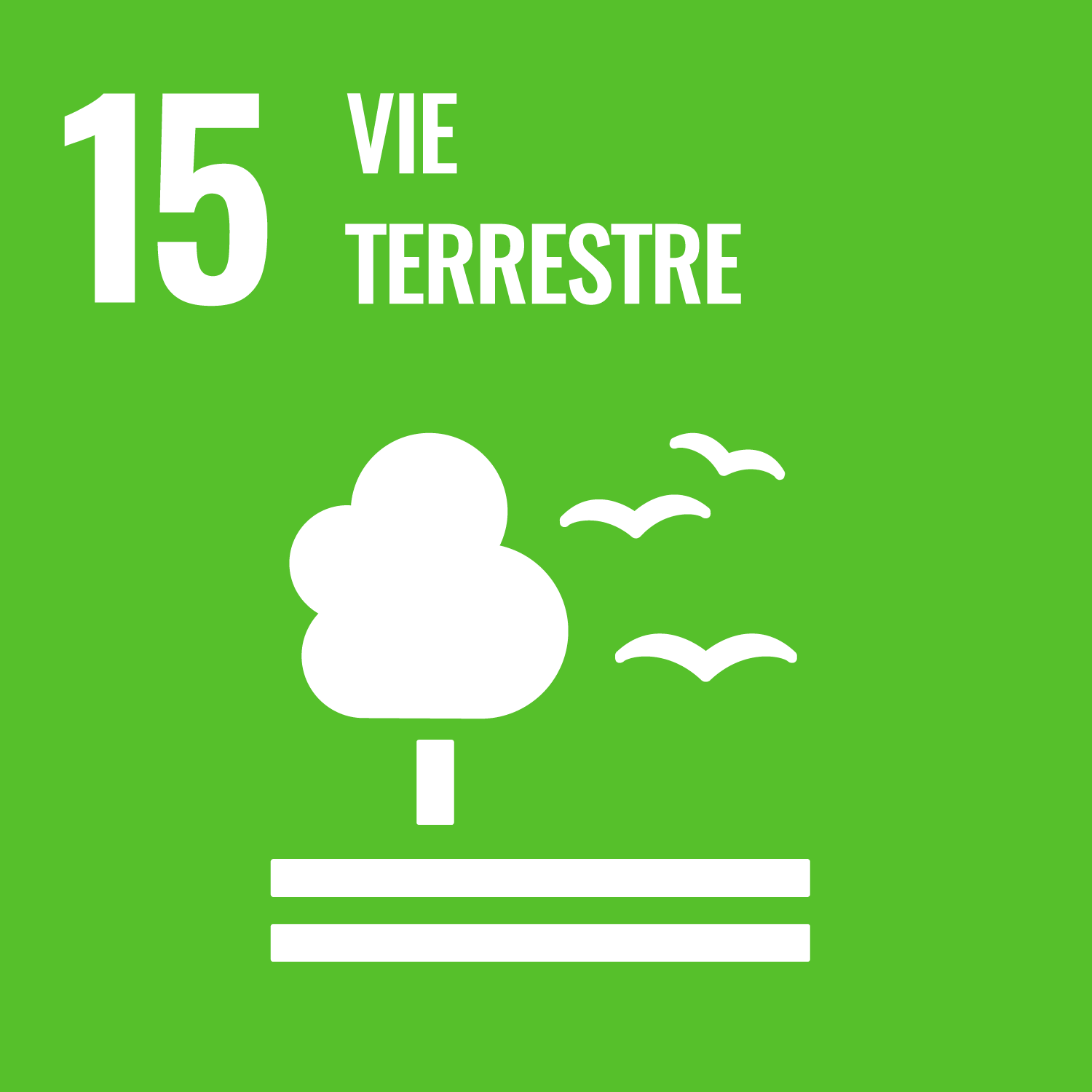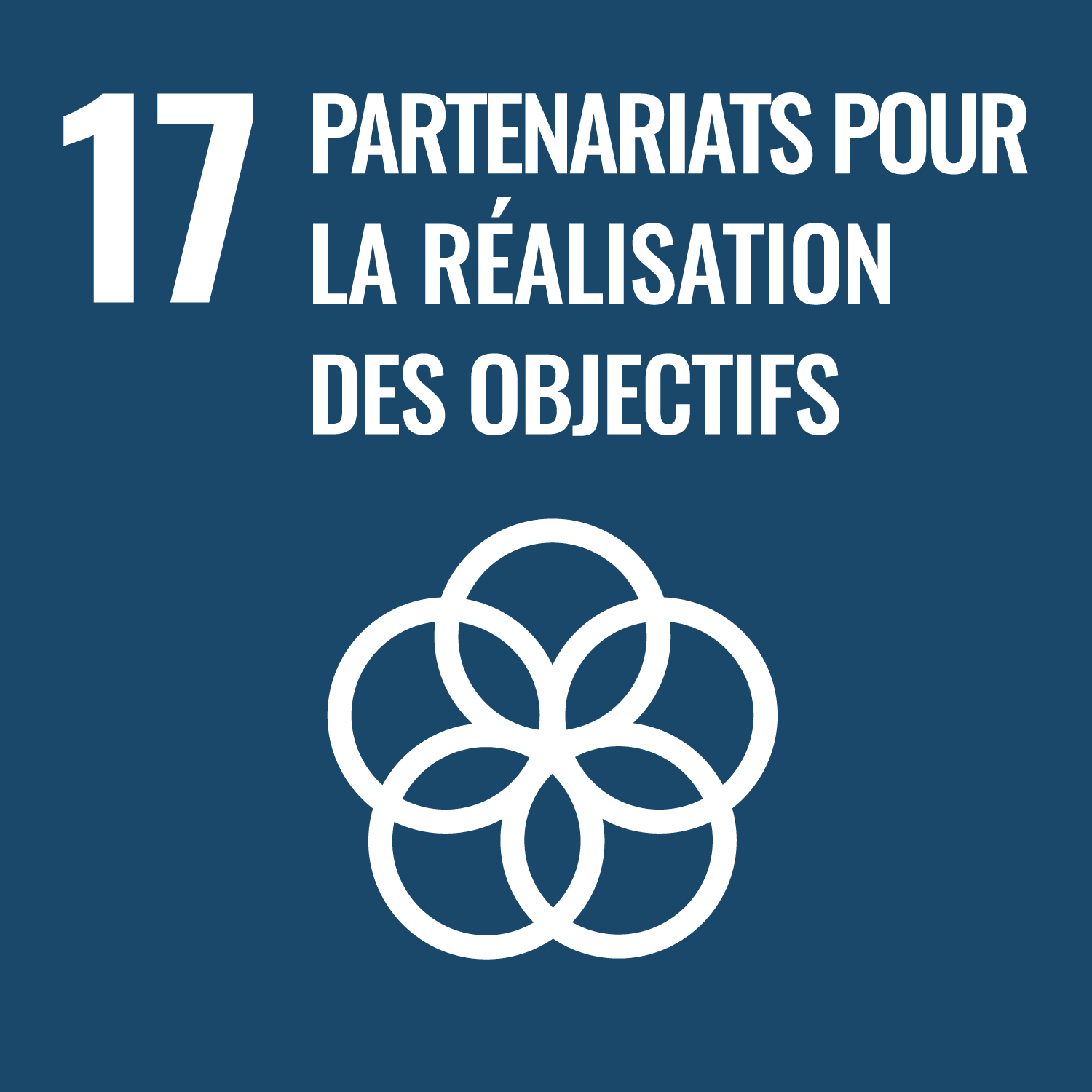Publication d’un nouveau document d’orientation sur l’évaluation de projets de l’OIBT en Afrique
18 août 2022

Des agriculteurs d'un village dans une surface forestière restaurée dans la Réserve forestière de Pamu Berekum, au Ghana, où a été mis en œuvre un projet de l’OIBT. Photo: Emmanuel Antwi Bawuah
Yokohama, Japon, 18 août 2022: Il ressort d’une évaluation de dix projets de l’OIBT en Afrique de l’Ouest et centrale qu’ils ont eu «d’importants effets favorables sur les forêts, leur gestion et les collectivités locales» dans les pays où ils ont été mis en œuvre, indique un document d’orientation que publie l’OIBT cette semaine.
Le document d’orientation intitulé Enseignements pour une bonne collaboration dans les forêts africaines dresse une synthèse des enseignements tirés des dix projets et propose de futurs domaines de collaboration entre l’OIBT et la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD). Lancée en 1993, la TICAD est une initiative japonaise dont l’objectif est de tirer parti des connaissances et ressources de la communauté internationale pour contribuer au développement accru de l’Afrique.
«En tant qu’organisation internationale basée au Japon, l’OIBT reconnaît l’importance d’une collaboration étroite avec la TICAD pour renforcer d’autant la foresterie durable en Afrique et aider ainsi à réaliser les objectifs de l’OIBT dans cette région», a observé la Directrice exécutive de l’OIBT, Sheam Satkuru.
L’évaluation a posteriori qui fait l’objet de ce document d’orientation a examiné des projets de l’OIBT, approuvés entre 2010 et 2020 et aujourd’hui achevés, qui ont été exécutés dans le cadre du Plan d’action stratégique de l’OIBT 2013–2021. Six d’entre eux ont été menés en Afrique de l’Ouest et quatre ont couvert plusieurs pays du bassin du Congo. Le budget de l’OIBT a avoisiné 12,2 millions $EU au total, principalement abondé par le Gouvernement du Japon, les autres donateurs étant les Gouvernements de l’Allemagne, de l’Australie, de la Belgique, de la Chine, des États-Unis d’Amérique, de la Suède et de la Suisse. Les pays bénéficiaires ont également apporté des contributions substantielles d’ordre financier ou en nature.
Très divers, les projets répondent à des problématiques telles que la restauration des paysages forestiers, la gestion durable des forêts, le renforcement de l’enseignement forestier supérieur, la traçabilité du bois, l’amélioration des statistiques forestières et la foresterie villageoise.
Au Bénin, par exemple, un projet de l’OIBT a permis de reconnaître juridiquement et de délimiter 42 forêts sacrées et d’élaborer des plans simples de gestion forestière. Plus de 150 hectares de forêts sacrées ont été enrichies au moyen de plants d’essences précieuses et des espèces de faune ont été réintroduites dans certaines surfaces. Les populations locales continuent de bénéficier d’activités génératrices de revenus instaurées dans le cadre du projet dans des domaines tels que l’agroforesterie, l’apiculture, la pisciculture ainsi que la production et le commerce de produits forestiers non ligneux.
Selon ce document d’orientation, les enseignements dégagés de la mise en œuvre des dix projets peuvent être appliqués au cadre élargi de la coopération entre l’OIBT et la TICAD en vue d’aider à améliorer les résultats de futurs projets. Il s’agit là d’un point important sachant que les deux organisations s’emploient à aider les pays d’Afrique à aller dans le sens d’un développement durable.
«Nous sommes persuadés que nos membres en Afrique continueront de bénéficier d’un solide partenariat entre l’OIBT et la TICAD», a expliqué Mme Satkuru. «C’est ainsi que, moyennant un capital de départ suffisant, il est susceptible d’attirer des financements de la part de donateurs compte tenu du vif intérêt que manifestent nombre d’entre eux pour encourager le développement de la foresterie durable en Afrique.»
La publication de ce document d’orientation a été rendue possible grâce à une contribution financière du Gouvernement du Japon; il est disponible en anglais, espagnol, français et japonais. Le rapport intégral de l’évaluation a posteriori sera présenté lors de la 58e session du Conseil international des bois tropicaux en novembre 2022.